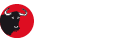Jour un. Des milliers de lacs, petites taches noires posées sur la neige comme la robe d’un dalmatien. Nous survolons déjà le Québec et les côtes du Golfe du Saint-Laurent.
Newark, un passage rapide devant les agents du U.S. Customs and Border Protection. L’uniforme bleu nuit de l’officier black et l’aigle doré épinglé fièrement sur la poitrine impressionnent un poil.
Une salade Caesar à 50 dollars plus tard, nous attendons toujours notre vol pour San José. Il partira avec une heure de retard. Pour tuer le temps nous contemplons le balais des avions sur le tarmac avec Manhattan en toile de fond, petits nuages sur le ciel du soir.
Alajuela, Aéroport international Juan-Santamaría, nous arrivons au Costa Rica. Cela fait plus de 25 heures que nous sommes debouts. Les enfants qui n’ont dormi que 4 heures en tout et pour tout sont bien braves. Taxi, pluie fine et brouillard dans la nuit. Seule la température nous rappelle que nous sommes dans un pays tropical.
Jours trois cent dix à trois cent douze. La carte de l’Argentine est scotchée aux murs de la cuisine, de gros cercles tracés au marqueur rouge indiquant les positions des barrages routiers. La télévision vomit son lot de nouvelles et d’images de paysans en colère. Les “Cortes del Campo” (la grève des agriculteurs) bloquent tous les accès aux grandes villes. Les supermarchés ne sont plus approvisionnés depuis deux semaines.
Pour contenir les prix à l’intérieur du pays et pour tenter d’enrayer la quasi mono-culture du soja dans le pays, mais aussi pour garnir son portefeuille, le gouvernement a décidé d’imposer une réforme sur les taxes agricoles. Tollé. Les quatre syndicats agricoles se sont exceptionnellement réunis pour lutter contre cette révision.
Du coup, la situation devient critique à Buenos Aires. La présidente dans un discours à la nation refuse de céder et le ton se durcit des deux côtés. Dans la capitale, les ménagères en colère sont descendues sur la Plaza de Mayo, casseroles et ustensiles à la main frappant sur le métal dans un boucan d’enfer. Un tel mouvement populaire n’avait pas eu lieu depuis la faillite de 2001. Les routes du nord bloquées, nous avons la chance de pouvoir rester un peu plus longtemps à Posadas dans notre super famille d’accueil.
Sur les bords de la rivière, nous rendons visite à Ruben qui organise un tournoi dans le club où il travaille en tant que professeur de tennis. Terre battue, soleil d’automne, jurons des joueurs et le maté qui passe de main en main dans les rangs des spectateurs. On deviendrait presque accrocs.
Petit tour par l’Aéroport international de Posadas “Libertador General José de San Martìn”. L’activité sur le tarmac n’est pas trop intense. Deux à trois vols par jour. Nous sommes absolument seuls dans le terminal admirant les vitrines de pierres précieuses et les statues des militaires tombés lors du conflit des Malouines.
En fin de journée, nous nous rendons avec Ana-Maria et Luciana dans un centre de réhabilitation de la faune. Quelques constructions éparses, de petites cages, des enclos. Ici, avec des moyens limités, un vétérinaire et quelques aides tentent de soigner puis de relâcher des animaux blessés ou capturés par la population. Le toucan retrouvera bientôt sa liberté, lui qui avait été mis en cage par quelques imbéciles pour faire joli. Les deux jaguars pourchassés par des bergers et sauvés d’une mort certaine par le centre ne verront plus jamais la jungle de leur enfance. Trop gros et désormais inadaptés à la vie sauvage. Idem pour le triste puma qui longe les grilles de sa taule à longueur de journée. Nous sommes épatés par le “zorro del Chaco” ou loup à crinière, sorte de renard monté sur échasses et passant son temps dans les marais à chasser les petits rongeurs, oiseaux, insectes et poissons. On ressort du parc un peu cafardeux, le centre manque cruellement d’argent et de soutient. La plupart des animaux sauvés par l’équipe ne sortiront plus jamais.
Dernière soirée avec les Blanchard. Ruben nous fait découvrir le Torrontes, vin blanc fabuleux, provenant de la région de Cafayate. Nous goûtons aux meilleurs empanadas du pays et partageons une dernière fois le maté avec nos hôtes.
Ana-Maria, Ruben, Luciana, Marite, merci à vous tous pour votre accueil et votre gentillesse !
Pretty, merci à toi pour l’organisation (à distance) de ces magnifiques rencontres.
Au revoir Posadas !
Jour trois cent neuf. Posadas, ville frontière. L’énorme pont “San Roque Gonzalez de Santa Cruz” traverse le rio Parana reliant ainsi la capitale de la Province de Missiones à la ville d’Encarnacion au Paraguay. Trafics et magouilles. Des dizaines de motocyclettes traversent la rivière à longueur de journée acheminant ainsi des cigarettes de contrebande, boîte par boîte en argentine.
Le Paraguay est après la Bolivie le pays le plus pauvre du continent. Des guerres à répétition suivies de trente-cinq années de dictature militaires talonnées par des dizaines de gouvernements corrompus ne lui ont jamais permis de sortir la tête de la fange. Les élections qui s’annoncent voient un ancien président de droite (ex-bagnard et vrai voleur) affronter un candidat de gauche (ex-évêque et vrai socialiste). Le pays va-t-il suivre la voie ouverte par les Lula, Chavez et autres Morales ?
Sur l’autre rive, Ana-Maria nous promène dans le quartier du marché. Des centaines d’échoppes bazardent tout et rien, du vrai et beaucoup de faux à des prix défiants toute concurrence. De l’iPhone désimlocké (un truc de geeks) au service à maté en cuir (un truc de beauf), des chaussettes de tennis en six-packs à l’écran plasma tout est à vendre dans ce fourbi aux couleurs et ambiances très orientales.
C’est ici que les argentins venaient faire leurs emplettes avant le marasme économique de 2001. L’après 11 septembre est très mal vécu. Les capitaux fuient le pays à tout berzingue ce qui précipite le système bancaire dans une grave crise. Afin d’éviter le chaos, le ministre de l’économie de l’époque limite les retraits d’argent à 250 pesos par semaine pour empêcher la population de changer toute sa monnaie en dollars. Cela provoque le courroux de la classe moyenne qui est ruinée par la très forte inflation. Grève générale, manifestations et répressions policière. Près de trente personnes y laisseront leur vie. En dix jours, quatre présidents se succèdent au pouvoir et le gouvernement se déclare en état de cessation de paiement. Le système de parité entre le peso argentin et le dollar ricain est abrogé. Sept ans après ces évènements, l’émotion est encore forte dans la population et la situation commence tout juste à s’améliorer.
Le temps de tamponner notre passeport et nous revoici en Argentine. On discute trafics et malversations. La rumeur circule dans la région que la principale compagnie de bus (dirigée par un trio de politiciens argentin, brésilien et paraguayen) serait le plus gros convoyeur de drogue entre les trois pays. Les bus jaunes et bleus possèdent même un terminal privé, à l’extérieur de la ville de Posadas, bien à l’écart des contrôles de la flicaille.
Jours trois cent cinq à trois cent sept. Elles forment la frontière entre le Brésil et l’Argentine. Certain les disent plus impressionnantes que les chutes du Niagara. Notre première impression des cataractes sera malheureusement entachée par la foule et la chaleur. Apprécier la beauté des chutes d’Iguazu en se faisant marcher sur les pieds et en se prenant les coups de coudes de milliers de touristes n’est pas si facile. Drôle d’idée que de s’aventurer du côté brésilien en plein Dimanche de Pâques…










Sur le chemin du retour, notre chauffeur freine brusquement pour éviter un énorme serpent noir et jaune qui sortant de sa jungle décide de traverser la route devant nos roues. Quelques minutes plus tard, le soleil se couche et nous plantons la tente dans un verdoyant camping. Une certaine hésitation se fait sentir. A chaque pas, le gnous (très inquiet) tape lourdement des pieds pour faire fuir les hypothétiques reptiles.
Le lendemain, c’est avec une certaine appréhension que nous partons cette fois du côté argentin du parc national d’Iguazu. Nous faisons la connaissance des coatis après seulement quelques mètres de marche. Ce petit animal omnivore, à la longue queue rayée se balade en bande sur les sentier du parc, promenant son museau rigolo à proximité des touristes. Mais la situation est trompeuse. La bestiole est en voie de disparition, en grande partie à cause des humains. De nombreux panneaux informent en quatre langues les visiteurs qu’il est strictement interdit de les nourrir et de les toucher (ils peuvent en mourir). Malheureusement et c’est bien connu, une jolie photo de vacances vaut mieux que la survie d’une espèce.
De passerelles en sentiers de terre rouge, nous flânons au milieu de centaines de papillons aux couleurs arc-en-ciel. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls à apprécier la dense végétation, la chaleur et l’humidité qui règne dans la région. Les crocodiles font aussi partie du décor.











Un petit train diesel, qualifié « d’écologique » par les administrateurs du parc nous emmène vers les grandes chutes. Elles en imposent. Elles sont là , devant nous et nous pouvons enfin les contempler sans nous faire bousculer. Tous les badauds sont sur le chemin du retour, partis dans la nuit.
De retour au campement, après avoir fait quelques brasses dans la piscine, nous faisons la rencontre d’un couple. Lui est argentin, elle espagnole et ils vivent tous les deux à Mar del Plata, station balnéaire au sud de Buenos Aires. Ils sont ici afin d’acheter de la terre pour le camping qu’ils vont bientôt ouvrir là -bas. Ils nous conduiront gentiment à notre station de bus, quelques kilomètres plus loin, histoire de nous éviter une belle transpirée dans cette moiteur tropicale.
Dans l’après-midi, nous regagnons la ville de Posadas. Nous y avions laissés une partie de nos bagages deux jours auparavant dans l’appartement de la famille Blanchard. Ana-Maria, Ruben et Luciana nous attendent pour notre première « parilla », mais cela est une autre histoire…
Jours deux cent soixante-deux à deux cent soixante-trois. Arturo Merino Benitez . Le créateur et ancien commandant de la « Fuerza Aérea de Chile » donne son nom à l’aéroport de Santiago. Le patronyme d’un militaire en guise d’ouverture sur le monde pour un pays qui compte deux Prix Nobel de littérature. Quel dommage ! Chez Arturo, les formalités de douanes sont expédiées en quelques minutes, ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants américains qui doivent, eux, s’acquitter d’une taxe « especiale ».
Nous voici donc au Chili. Nouveau continent, nouveau pays, nouvelle langue et… nouveau guide de voyage. Flottements, hésitations, les prises de décisions sont plus lentes et plus difficiles. Fidèles à nos habitudes, nous n’avons rien réservé et rien préparé à l’avance. Les cours d’espagnol que Valérie a suivi avant notre départ nous permettent de trouver un logement dans le quartier de l’Université catholique. Premiers kilomètres en bus et métro. Le dépaysement n’est pas flagrant. Santiago est une grande ville très « européenne ». A la pension nous partons à la récolte d’informations pour la suite du périple. On discute, on échange les bons plans avec d’autres voyageurs qui reviennent de Patagonie. Nous décidons de racheter une tente de camping à un couple d’australiens qui termine ici son séjour sud-américain.
Le lendemain, nous nous aventurons dans le centre-ville. Nous avions rencontré plusieurs personnes qui s’étaient fait voler leurs effets en pleine rue, nous restons donc sur nos gardes.
Le Cerro Santa Lucia, petite colline constellée de fontaines et de statues est dominé par les restes d’une ancienne forteresse. Quelques vieux canons rouillés, des amoureux qui se bécotent et une vue globale sur la cité qui s’étend autour de nous à perte de vue. Six millions d’habitants (près de quarante pour cent de la population du pays) vivent ici au pied des Andes et à une petite centaine de kilomètres de l’Océan Pacifique.
On s’aventure dans le « Museo Nacional de Bellas Artes » où nous nous laissons séduire par deux belles expositions. L’une traite de l’architecture dans les pays nordiques et de l’intégration des bâtiments dans des zones à climats extrêmes. Dépaysant. La seconde, est une magnifique rétrospective de l’oeuvre de l’architecte colombien Rogelio Salmona, assistant du Corbusier et connu pour son usage abondant de la brique en terre cuite. Il eut la chance de pouvoir réaliser d’énormes projets dans son pays.
Sur la « Plaza de la Constitucion », devant le « Palacio de la Moneda » trône la statue de Salvator Allende. Ce président à lunettes décéda pendant le coup-d’état de 1973 (fomenté notamment par la CIA américaine) et qui installa le Général Pinochet au pouvoir pendant dix-sept ans. Si vous en avez l’occasion, jetez un oeil à l’excellent film de Costa-Gavras « Porté disparu » (Missing, 1982 ) qui relate bien les évènements de cette période. Durant ces années de dictature militaire, des milliers de chiliens et chiliennes furent torturés et assassinés par la junte. Le vieux Pinochet qui est mort en 2006, échappa à tout jugement après une impressionnante saga judiciaire.
La plus riche nation du continent a élu une femme socialiste à sa présidence en la personne de Michelle Bachelet, ancienne prisonnière politique et opposante au régime militaire. Juste retour des choses ?
Jours deux cent cinquante-neuf à deux cent soixante et un. Un avion en retard. Quelques bons de repas en guise de compensation. Des gnous qui courent tout heureux de bistrots en Mc Do. Plusieurs heures à tuer dans l’aéroport d’Auckland. Un dernier regard sur la Mer de Tasmanie avec ses îlots qui se détachent de l’horizon dans la lumière du couchant. La farandole des 747 sur le tarmac. Un pilote qui somnole dans une aire d’embarquement isolée. Des visages qui pleurent et des familles qui courent sur les escalators alors qu’une voie irréelle crie leur nom dans les haut-parleurs.
Faut-il comprendre que notre passage dans la grande ville du nord se résume à une attente aéroportuaire ? Bien évidemment non.
Auckland est une ville toute en montée et en descente. Une cité où les buildings de verre et de métal du quartier des affaires cèdent vite la place aux amusantes petites maisons en bois de Ponsomby. C’est aussi la « ville des voiles » avec le « Viaduct Basin » qui accueillit deux éditions de la « Coupe de l’America ». Des yachts de luxe, la base permanente du « Team New Zealand » et les anciens locaux du « Team Alinghi ». C’est Queen Street avec ses boutiques de luxe et ses restaurants asiatiques. Karangahape Road, notre rue pour deux nuits, notre pension au milieu des sex-shops et des travestis.
Auckland c’est aussi le temps d’une dernière sieste en territoire kiwi sur les hauteurs du Myers Park. Se dire que nous quittons un pays merveilleux, riche et (c’est si rare) tout en finesse. On admire un dernier coup les reflets du soleil sur la « Sky Tower » et l’on coure pour mieux attendre dans les couloir de l’aérogare.
Dans la nuit, un « Hola ! » chaud et latin nous accueille alors que nous embarquons enfin dans l’Airbus A340 de la LAN Chili. Treize heures de vol. Une immensité d’eau et peut-être si la chance est avec nous un coup d’oeil sur l’Antarctique que nous survolerons presque…
Jours deux cent trente-trois à deux cent trente-cinq. Un saut de puce. Même pas le temps de finir notre plateau repas de midinette. Alors que nous prenions un plaisir maniaque à ranger nos tupperwares aéronautiques les uns dans les autres, le Boeing s’approche déjà des côtes.
La Mer de Tasmanie cède la place à des montagnes enneigées. Même de là -haut elles impressionnent, noires et grises, tachées de blanc, tendues et cassantes. Suivent un enchevêtrement de lacs turquoises et de sombres forêts. Nous survolons des collines jaunies, des rivières en zigzag, des ovales de courses et des moutons, beaucoup de moutons. Et voici déjà l’Océan Pacifique. Quatre minutes en tout et pour tout d’une mer à l’autre. Crissements de pneus. Atterrissage à Christchurch, Nouvelle-Zélande, île du sud. Quatorze heures vingt-cinq heures locale. Quatre heures du matin à Lausanne. Petit soleil, dix-sept degrés sur le tarmac.
On traverse une ville bien rangée aux parcs très britanniques. Nous nous dégotons une sympathique pension avant de faire quelques courses et au lit.
Le lendemain, attablés à un café, nous regardons passer les vieux trams retapés pour les touristes. Nicolas feuillette le journal du weekend épais comme une bible tandis que Valérie dévore les dernières pages d’un roman trouvé à Darwin.
La famille chez qui nous devions travailler à Dunedin ne nous a toujours pas répondu. On décide donc de changer de plan. Après plusieurs heures de recherches, nous louons une « voiture de camping » pour dix jours. L’offre la moins chère du marché. Nous sillonnerons donc l’île du sud avec un joli petit break blanc. Un air de déjà vu ?
Nous partons à la découverte de la ville. L’église du Christ est facile à trouver. L’immense cathédrale anglicane trône au centre de la petite capitale du Canterbury néo-zélandais. Architecture gothique entourée de maisons de bois peintes avec goût. Au détour d’une rue, nous tombons sur le « Swiss Café ». Le patron est un suisse-allemand rigolo qui sert des assiettes de véritables Gruyère et Emmental. La fondue est au menu. Nous craquons pour un encas qui nous ramène tout droit dans les pré-alpes. Un vrai régal ! On se promet de revenir le soir pour le coup du milieu.
Sur Cathedral Square, devant les vitraux de la maison de Dieu, un punk en kilt vient de parquer sa camionnette frigorifique. Il ouvre les portes arrières. Allume son ampli, lance une bande enregistrée avec guitare et voix et se met à taper comme un fou sur sa batterie. Superbe vacarme. Les badauds s’arrêtent intrigués. L’homme à la crête est en forme. Un policier lui demandera gentiment de ne pas réveiller les anges … et d’aller tambouriner ailleurs.
Le soleil se couche sur les croix et les buildings. Complètement déchaînés, nous avons rendez-vous avec notre fondue. Malheureusement le petit restaurant de New Regent Street s’avérera fermé en soirée. Déçus, on se venge sur un Chicken Tikka Masala dans le bistrot indien d’à côté ouvert lui en continu…
Le jour du Seigneur, en parfaits mécréants, nous en profitons pour visiter le musée d’art de la ville ainsi que le centre culturel installé dans un magnifique ancien collège (gothique également). Jolie sieste dans le Botanic Garden avec comme fond sonore un concert de soul/jazz efficace et gratuit. Non loin de là , les bateliers filent sur les eaux tranquilles de l’Avon avant de rejoindre leur joli ponton de bois sur Cambridge Terrace.
Jour cinquante-deux. Tout d’abord, il y a la montagne. En bons petits suisses, on croit connaître. Mais le Mont-Kazbek (le plus haut sommet de Géorgie) rigole quand on lui parle du Mt-Blanc. C’est qu’il culmine à cinq mille quarante-sept mètres le bougre ! On le regarde tous les quatre un peu émus. Il fait son timide caché dans les nuages.










Et puis il y a cette vallée. Austère, aux pentes abruptes et vertes, sans rochers ni cailloux. L’herbe semble y tenir toute seule, comme par magie. Quelques pylônes rouillés. La rivière qui part arroser les plaines de Tchétchénie.
Enfin il y a les bergers. A cheval. De gros chiens oreilles et queue coupées rabattent vaches et moutons.
Nous sommes au milieu du Caucase, mais les visages sont déjà asiatiques. Regards clairs, yeux bridés et toque de laine.
Nous sommes arrivés ce matin à Kazbegi accompagnés par Nathalie et Simon. Cent kilomètres de route sur la « Georgian Military Highway ». Un col à plus de deux mille mètres d’altitude, perdu dans le brouillard.









On regarde passer goguenards ces incroyables Lada Niva en buvant un breuvage caféiné russe infecte. Trois clébards ont la bonne idée de venir se coucher sur nos pieds glacés. Petits frissons dans le dos et éternuements. Trente-cinq degrés à Tbilissi, douze à Kazbegi. On s’est fait avoir. Faites chauffer le Néo-Citran.

Amérique centrale, Avion, Capitales, Frontières, Villes, Voyage

Amérique du Sud, Frontières, Voyage

Amérique du Sud, Frontières, Voyage

Amérique du Sud, Frontières

Amérique du Sud, Capitales, Frontières, Villes, Voyage

Frontières, Îles, Mer, Océanie, Villes, Voyage

Frontières, Îles, Mer, Océanie, Villes, Voyage

Caucase, Frontières, Montagne, Voyage